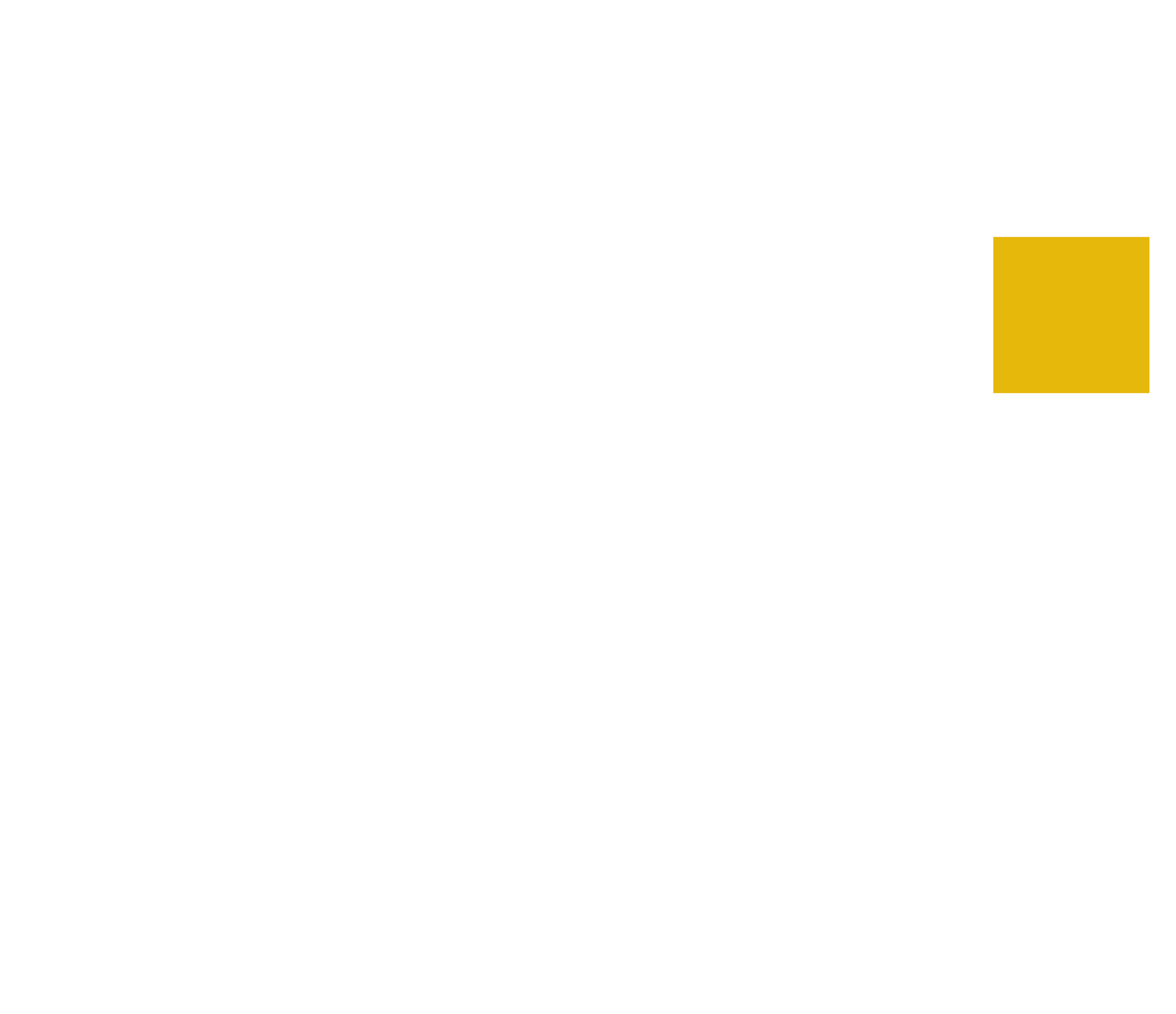Comment penser par soi-même, à l’heure de l’intelligence artificielle (IA), quand les algorithmes interfèrent en permanence avec le comportement et les décisions individuelles, à la fois pour les apprentissages des enfants, la conduite familiale et professionnelle, les existences humaines dans leur quasi-totalité ? Le déferlement dans la vie des humains des technologies digitales, en particulier celles qui visent le fonctionnement cérébral, vont-elles annihiler la « raison » et l’«entendement », chères au philosophe allemand Kant et du même coup la possibilité pour les humains de vivre une existence autonome ?
Paris, en 2050 :
Le Directeur des Ressources Humaines scrute, au travers son implant rétinien de réalité augmentée, la candidate au poste de directeur marketing du Groupe. Il observe avec satisfaction que, dans le monde digital de 2050, la motivation, les capacités d’abstraction symbolique, d’imagination et de créativité continuent de caractériser les humains.
Comment cela a-t-il été possible ? Comment l’humain de 2050, en symbiose avec l’IA, garde t-il sa capacité de discernement, de raisonner par lui-même, de développer sans cesse des théories et des concepts nouveaux ? La réponse est simple : l’humain a conçu et mis en œuvre des règles strictes de santé digitale.
A la fin des années 2020, à la naissance de la première IA s’exprimant quasiment comme un humain, le monde avait réellement pris conscience de la puissance de l’IA et de ses capacités potentielles. Le monde a retenu son souffle : omniprésentes, stimulantes, communicantes, enregistrantes, prévenantes… mais tellement envahissantes ! Comment l’humanité allait-elle garder le contrôle de ces IA devenues indispensables ? Sur cette question, plusieurs hypothèses étaient alors débattues, et divisaient la population entre trois grands courants de pensée, les technofix, les luddix et les kantix :
1) Les technofix, bio-libéraux, pour qui le cerveau humain fonctionnant comme une machine - sur la base d’un simple traitement de l’information-, l’humain et la machine allaient tranquillement s’hybrider et se fondre, l’humanité classique s’effacer au profit d’individus symbiotiques.
2) Les luddix (i), bio-conservateurs, pour qui le corps humain devait être figé en l’état, sans qu’aucune modification biologique ne puisse être tolérée, et les technologies susceptibles d’altérer cette « essence humaine » totalement bannies.
3) Les kantix, convaincus que pour conserver ses spécificités cérébrales et mentales, la société humaine devait s’inspirer de la théorie des « moments critiques » (ii) pour le développement des enfants. Durant ces périodes critiques, qui structurent le développement cérébral, les enfants sont tenus à distance des IA trop intrusives. Ils préservent de cette manière pour le reste de leur existence leurs prodigieuses capacités humaines.
Les arguments du troisième groupe ont généralement convaincu. Aujourd’hui en 2050, les apprentissages se font selon ce calendrier d’ouverture et de fermeture des périodes critiques. Le cerveau des jeunes humains, ainsi développé et structuré, leur permet de rester autonome vis-à-vis des IA. Il leur permet aussi de vivre des moments déconnectés (des moments de « vacances » qui peuvent être choisis mais aussi inopinés en cas d’incident technologique), sans avoir le sentiment de perdre leur identité ou certains traits fondamentaux de leur personnalité. L’humain, s’il vit en symbiose avec ses prolongements digitaux, a été capable de conserver son humanité. L’IA est reste à sa place, celle d’un outil très sophistiqué.

Elisabeth de Castex